Modéliser la mécanique des biofluides
Date:
Mis à jour le 04/08/2022
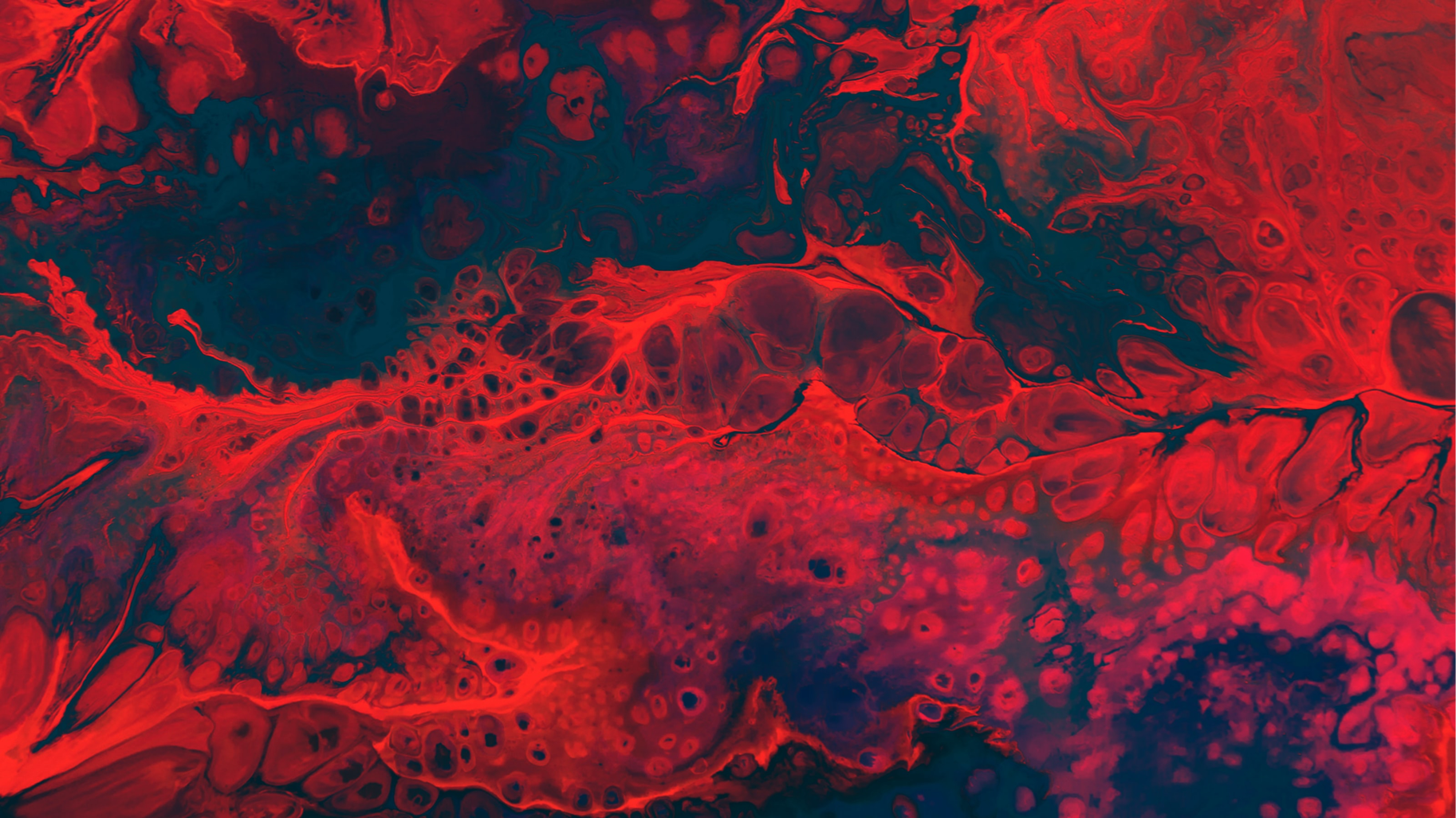
Commedia c'est du sérieux. Rien à voir donc avec celle dite “dell'arte” ! Cet acronyme signifie en anglais Computational mathematics for biomedical applications, et donc "mathématiques et calcul scientifique pour les applications biomédicales" en français. Cette équipe-projet commune au centre Inria de Paris, à Sorbonne Université et au CNRS, a été créée mi-2019. « La plupart des membres permanents sont issus de l’ancienne équipe-projet REO dirigée par Jean-Frédéric Gerbeau, aujourd'hui directeur général délégué à la science d'Inria », indique Miguel Fernández, responsable de Commedia. Le chercheur a rejoint Inria en 2004 après un doctorat en mathématiques appliquées à l'université Paris-Dauphine et un postdoctorat à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.
La simulation numérique des écoulements du sang dans le système cardiovasculaire, et de l’air dans le système respiratoire, est au cœur des objectifs de Commedia. « Nous utilisons les mathématiques appliquées (autrement dit l'application du savoir mathématique aux autres domaines scientifiques, comme la médecine ou l’ingénierie) pour essayer d'apporter des réponses aux questions que se posent des médecins, des chirurgiens et des industriels de la biotech qui développent des dispositifs médicaux », explique Miguel Fernández. L'équipe Commedia rassemble déjà une vingtaine de personnes venant du monde entier, dont quatre chercheurs et chercheuses d’Inria, douze doctorants et doctorantes, un ingénieur de recherche d’Inria ainsi qu’un postdoctorant et une postdoctorante. « S'y ajoutent deux membres issus du prestigieux laboratoire de recherche en mathématiques appliquées Jacques-Louis Lions (LJLL) : une enseignante-chercheuse, et un enseignant-chercheur qui vient tout juste de nous rejoindre », précise Miguel Fernández.
En matière de recherche, les "Commédiennes" et "Commédiens" – comme elles et ils aiment s'appeler – se concentrent sur trois grands enjeux :
Des exemples ? Commedia travaille notamment sur des outils de simulation qui permettent de tester des dispositifs médicaux ou des médicaments apportés à des maladies respiratoires. « L'un des buts est de comprendre et de simuler les mécanismes par lesquels des mélanges d’air facilitent la respiration de sujets qui souffrent d'asthme », détaille le chercheur.
Les travaux de Commedia sur la modélisation des écoulements biofluides sont parfois proches des recherches effectuées dans d'autres domaines, comme l’aéronautique ou la géophysique : « Nous partageons certains types de modèles mathématiques car les lois de la physique sont universelles. Nous discutons par exemple avec des collègues qui développent des outils de simulation d’hydroliennes ou d’éoliennes, précise Miguel Fernández. Mais les régimes physiques de fluides qui interagissent avec une aile d'avion, une pale d'éolienne ou un tissu vivant ne sont pas identiques. Le fait de changer d'application nécessite souvent d’innover sur les modèles mathématiques et sur les méthodes de simulation numérique. »
Actuellement, des chercheurs et des chercheuses de Commedia sont impliqués dans un projet de recherche sur l'insuffisance mitrale, financé par l'ANR (Agence nationale de la recherche) et mobilisant des chirurgiens cardiaques de l'hôpital Louis-Pradel (Hospices civils de Lyon), le principal centre cardiologique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette initiative est dénommée SIMR, pour Simulation et imagerie pour la régurgitation mitrale. Il vise, selon Miguel Fernández, « à améliorer la compréhension et le traitement de pathologies de la valve mitrale », celle qui relie l’oreillette et le ventricule de la partie gauche du cœur. L’insuffisance mitrale étant la deuxième cause de chirurgie valvulaire en France.
« Des chirurgiens de cet hôpital ont développé un outil innovant permettant de mesurer les tensions des cordages artificiels implantés pour réparer la valve mitrale, à l'intérieur même du cœur ; ils estiment qu'une faible tension devrait être un indicateur objectif de valve bien réparée, détaille le directeur de recherche. Nous avons été sollicités pour développer des outils de simulation qui devraient permettre de vérifier numériquement cette hypothèse, à partir de données de patients (IRM, scanner...) obtenues dans le cadre d’une étude clinique menée à Lyon. »
Par l'intermédiaire de Mocia Agbalessi, l'une de ses doctorantes, l'équipe collabore en outre avec Casis, une startup dijonnaise spécialisée dans la conception d'outils de traitement d’images médicales. Le but ? Utiliser des outils de simulation numérique pour prédire le risque de rupture d’un anévrisme aortique (dilatation anormale de la paroi de l’aorte), les techniques actuelles se basant sur des critères purement anatomiques qui présentent beaucoup de limites. La difficulté ? « Il faut pouvoir adapter les simulations numériques à chaque patient en les enrichissant avec ses données cliniques IRM de flux 4D, qui fournissent une information spatio-temporelle non invasive (obtenue sans intervention) de la vitesse du sang dans l’aorte », souligne Miguel Fernández. Les IRM de flux 4D permettent de visualiser ces informations dans les trois plans de l'espace, au cours du cycle cardiaque.
Grâce à l'équipe associée Imfibio (Innovative Methods for Forward and Inverse problems in BIO-medical applications dont Muriel Boulakia, "commédienne" du LJLL, est la coordinatrice) Commedia s'est rapprochée du département mathématiques de UCL (University College of London). Elle est financée par Inria depuis 2020 et doit renforcer la coopération en matière de recherche sur les solutions de simulation numérique des valves cardiaques et l’interaction entre données et simulation, grâce à des visites croisées de leurs chercheurs respectifs. Les déplacements n'ont pu avoir lieu en 2020 du fait de la pandémie. Mais ce n'est que partie remise.

Directeur de recherche de l'équipe-projet COMMEDIA et directeur scientifique du centre Inria de Paris